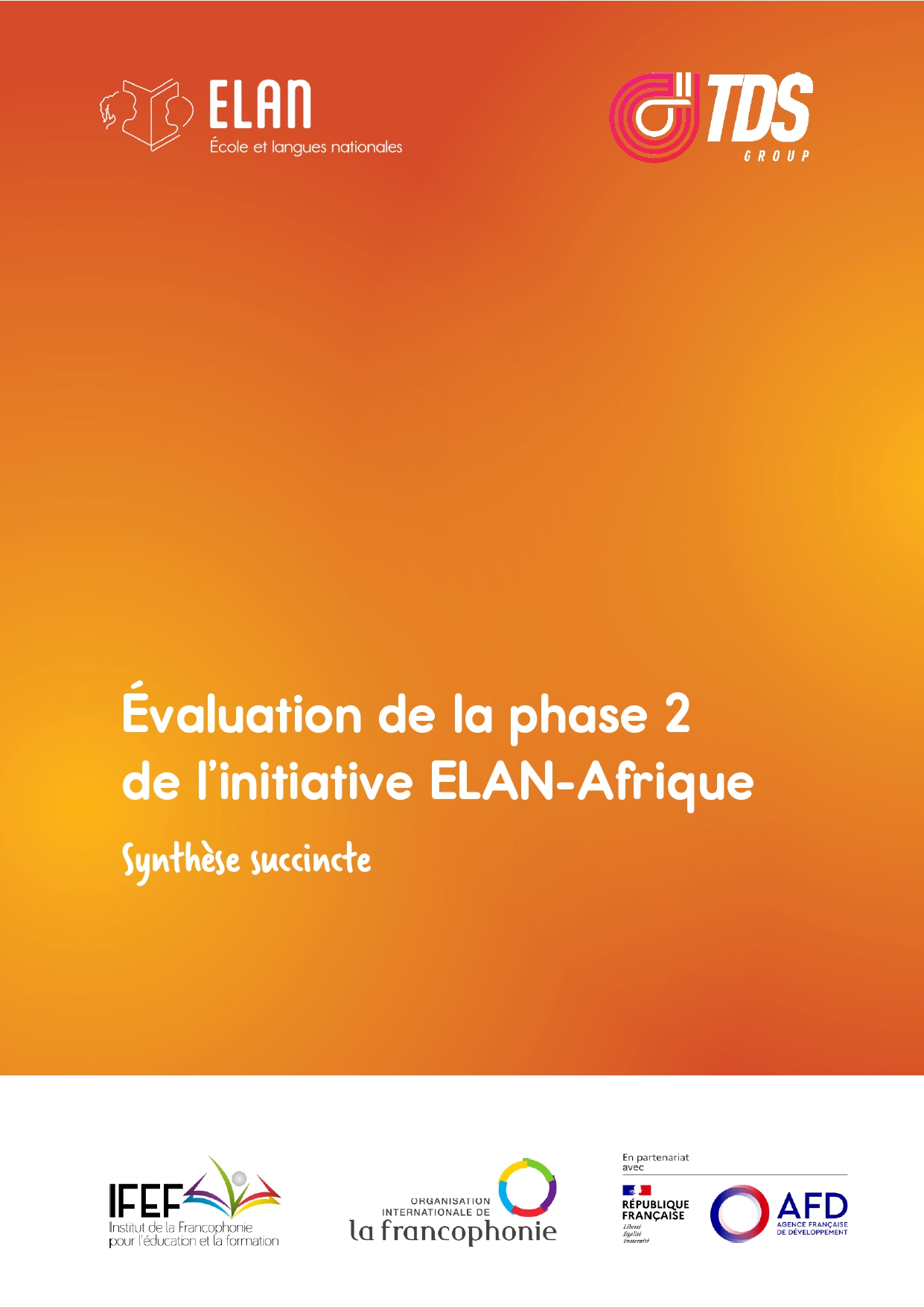Le présent document a été élaboré avec l’aide de l’IFEF-OIF et des parties prenantes de l’initiative ELAN. Le contenu de ce document relève de la seule et entière responsabilité de TDS-Group et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’OIF/IFEF et de l’AFD. L’analyse, les opinions et les points de vue exprimés sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’OIF/IFEF ni de l’AFD. Ainsi seule la responsabilité de l’auteur pourra être engagée.
type de ressource : Guide
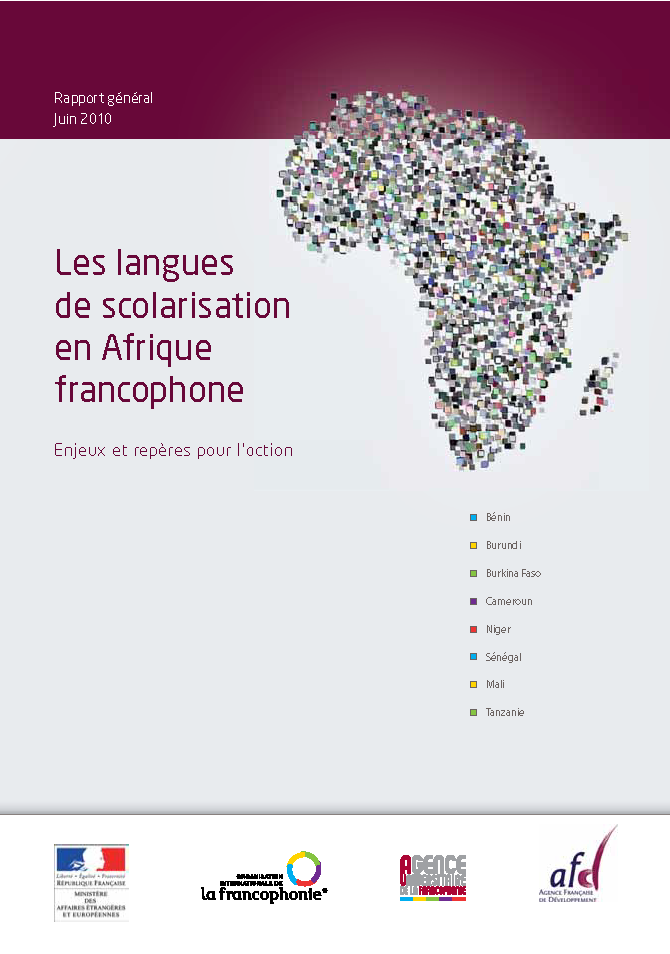
- Guide
Description
Le projet intitulé Les langues de scolarisation dans l’enseignement fondamental en Afrique subsaharienne francophone (LASCOLAF) a été mené conjointement, depuis 2007, par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats (DGM) du ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE), l’Agence française de développement (AFD) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). L’objectif prioritaire de ce programme, tel qu’il a été défini lors de sa mise en place, réside dans l’identification des stratégies pédagogiques les mieux appropriées dans le contexte multilingue africain, au service d’une meilleure efficacité des politiques linguistiques définies depuis les états généraux de Libreville (2003).
La mobilisation internationale en faveur de la scolarisation primaire universelle a profondément modifié la démographie scolaire des pays africains, au cours de la dernière décennie. En Afrique subsaharienne, les effectifs scolarisés dans le primaire ont progressé de 82 à 124 millions entre 1999 et 2007 1. Le nombre de ruraux a fortement augmenté et une grande partie de ces élèves éprouvent des difficultés avec la langue française, médium d’enseignement dès la première année d’école dans les pays d’Afrique subsaharienne francophone, lorsque cette langue n’est pratiquée ni dans la famille, ni dans le village.
La langue première de l’élève exerçant une influence déterminante sur son développement cognitif et affectif, son utilisation dans l’enseignement primaire favorise les apprentissages fondamentaux et rend plus aisée l’acquisition progressive d’une langue seconde ou étrangère. Le recours au bi/plurilinguisme scolaire à ce niveau d’apprentissage devrait permettre de réduire l’échec scolaire et les abandons en cours de scolarité. C’est pourquoi plusieurs pays francophones ont introduit ces dernières années l’enseignement en langues nationales dans le cycle primaire, en complément du français. Ces expérimentations méritaient d’être documentées et analysées pour identifier les difficultés de mise en œuvre et consolider les processus de réforme.
L’étude souligne que le processus d’introduction des langues africaines à l’école demeure complexe. Elle ambitionne de baliser méthodiquement la planification des différentes étapes des processus de réforme. Celle-ci doit s’inscrire dans la durée, s’appuyer sur des recherches continues en linguistique appliquée pour élaborer de meilleurs outils de didactique intégrée des langues, suivre plus rigoureusement les expérimentations et adapter les dispositifs de formation des enseignants et les manuels scolaires. Elle doit aussi donner une large place aux actions de sensibilisation à l’intention des différents acteurs et notamment les enseignants et les familles. Il s’est agi de réaliser un état des lieux des orientations et des pratiques en matière de langues de scolarisation dans des pays sélectionnés par le comité scientifique sur la base de typologies sociolinguistiques et de la disponibilité d’experts (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Niger, Sénégal, les expériences du Mali et de la Tanzanie sont également prises en compte).
© OIF, 2010
Les langues de scolarisation en Afrique francophone. Enjeux et repères pour l’action.
Rédaction coordonnée par Bruno Maurer, membre du Comité scientifique et rapporteur du projet LASCOLAF.
Licence : CC BY-NC-SA 4.0

Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International
Cette publication peut être citée comme suit : « OIF (2010). Les langues de scolarisation en Afrique subsaharienne francophone (LASCOLAF) : Enjeux et repères pour l’action. Paris, Éditions des archives contemporaines. »
- Année de publication : 2010
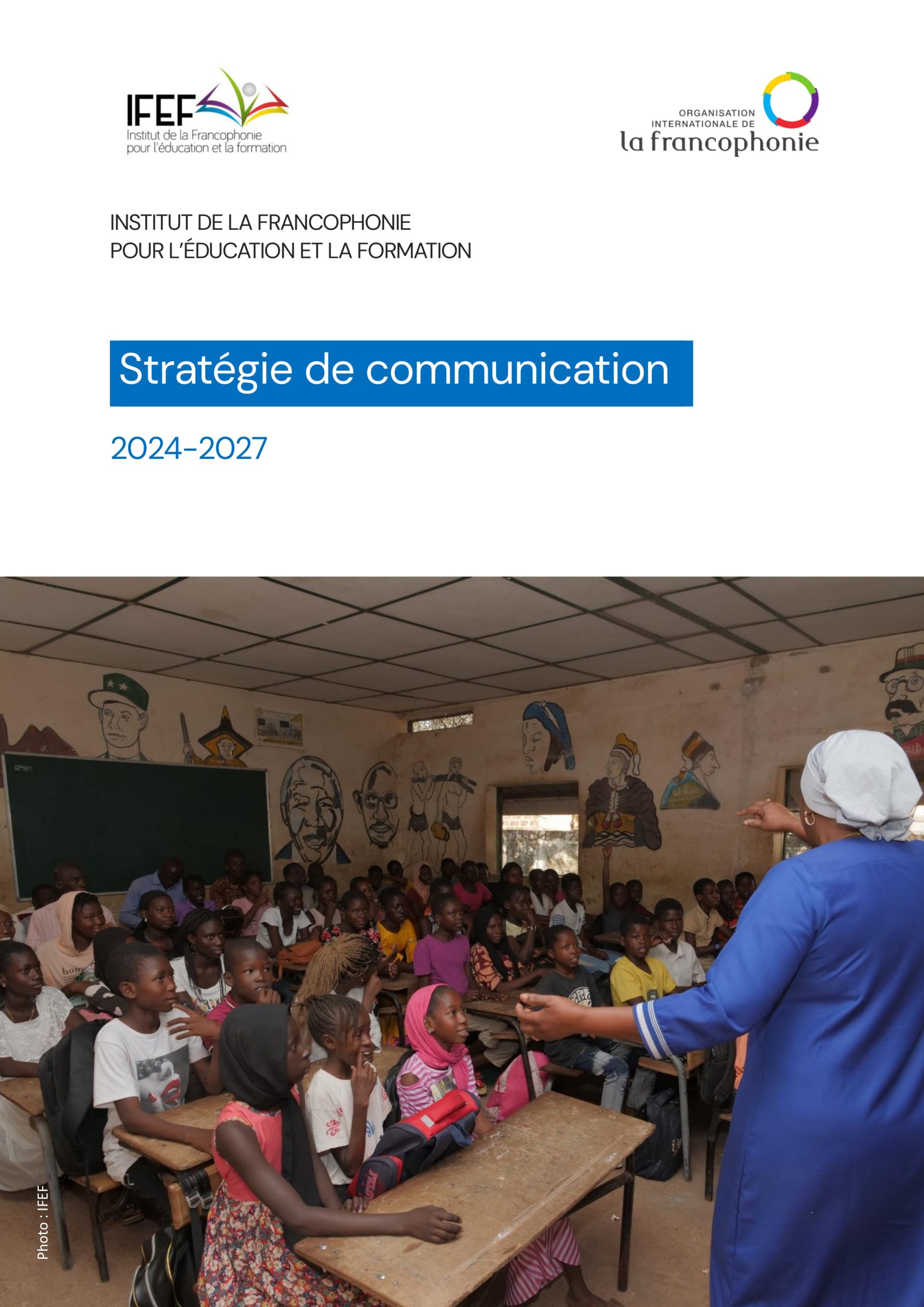
- Guide
Le présent document constitue la stratégie de l’IFEF visant à expliciter l’approche de la communication pour la période 2024-2027. Il fournit les éléments d’un cadre théorique et des orientations pratiques sur la communication globale de l’IFEF.
Résumé
Dans le prolongement de cette programmation et de la Stratégie de l’IFEF, le présent document constitue la Stratégie de communication de l’IFEF 2024-2027 et vise alors à cadrer, définir et détailler l’approche et orientations stratégiques de communication pour atteindre les objectifs, les ambitions de développement et les résultats attendus en lien avec sa vision. Elle se concentre sur des objectifs clés pour renforcer son rôle et son impact dans le domaine de l’éducation et de la formation dans l’espace francophone et plus particulièrement aux seins des communautés et populations francophones.
En effet, la Stratégie de communication de l’IFEF au cours des quatre prochaines années est construite en cohérence avec les ambitions à atteindre tels que définis notamment dans la Stratégie de l’IFEF et la Stratégie communication de l’OIF pour 2024, à savoir :
▪ Pertinence et proximité
▪ Visibilité dans les médias
▪ Engagement de nos publics cibles
© IFEF, 2024. Tous droits réservés.
Auteure : Vjosa REXHEPI
ISBN : 978-92-9028-768-1 (numérique)
Licence : CC BY-NC-ND 4.0

Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification 4.0 International
Cette publication peut être citée comme suit : « IFEF (2024). Stratégie de communication de l’IFEF 2024-2027. Dakar, IFEF. »
- Année de publication : 2024
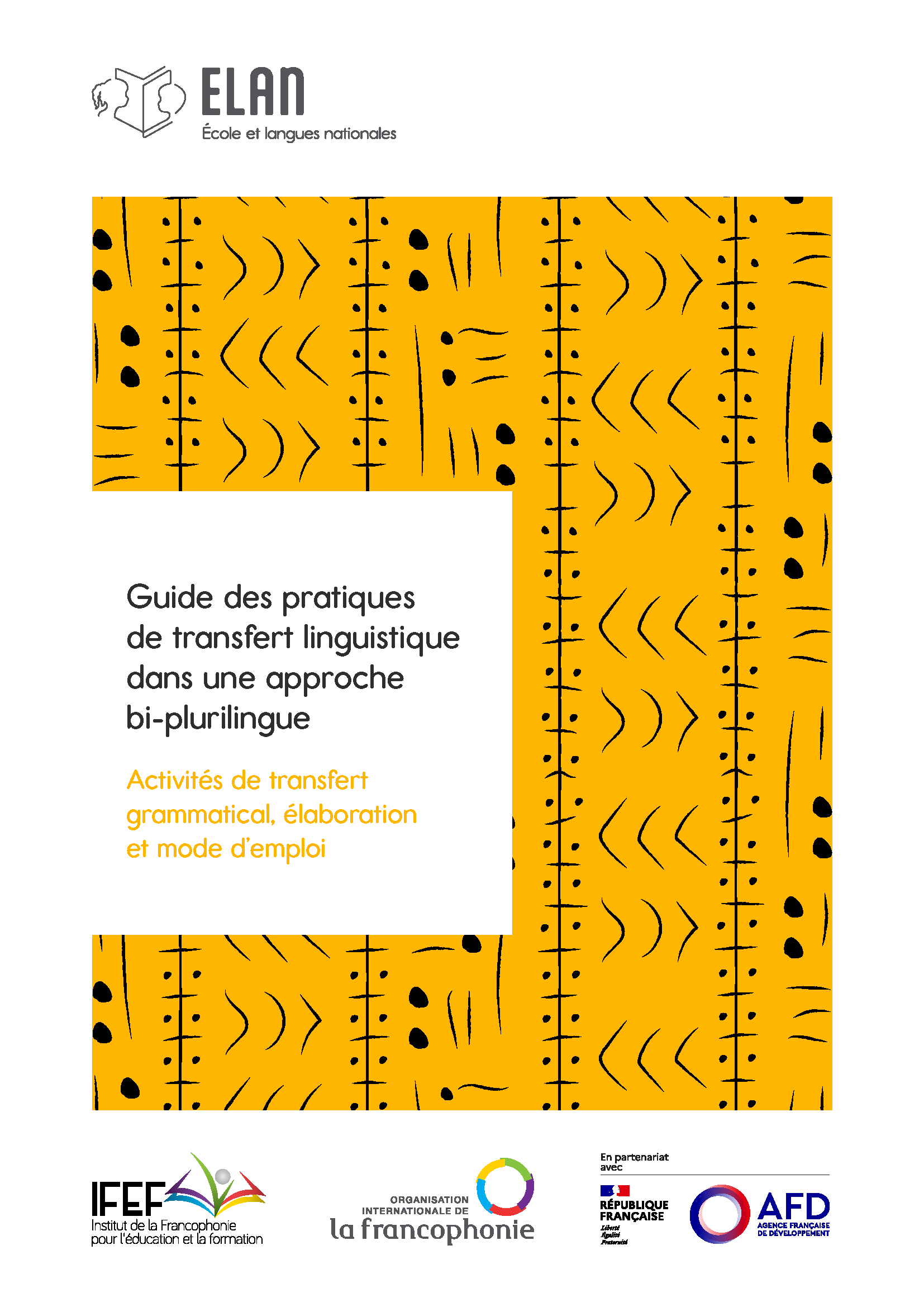
- Guide
Le présent guide constitue un outil pour les cadres de l’éducation de base, dans les pays concernés par une approche bi-plurilingue de l’éducation de base, ainsi que pour les formateurs d’enseignants et les formateurs. Il fournit des éléments pour permettre un transfert linguistique et éclairer leur suivi pédagogique par la maitrise de ce domaine. Il est également destiné aux concepteurs de manuels, devant inclure des démarches de transfert dans les supports qu’ils conçoivent.
Description
Ce guide porte sur les transferts d’apprentissage dans le domaine de la grammaire de la L1 et de la L2 dans les classes bilingues. Il traite des transferts linguistiques dans le domaine de la langue, pour organiser les apprentissages grammaticaux sur la base de ce qui est déjà-là et déjà-construit à partir de la L1.
L’objectif de ce guide est de contribuer au renforcement des capacités des formateurs d’enseignants des écoles primaires bi-plurilingues, en les aidant à concevoir et à animer des activités de transfert linguistique entre les langues africaines L1 et le français L2. Il souhaite aider les équipes des pays à s’approprier les démarches d’élaboration de fiches de transfert linguistique, pour permettre leur diffusion sur le terrain et l’accompagnement des maitres à les utiliser pour des activités de grammaire reliant les deux langues.
Il se propose de/d’ :
- servir d’outil d’autoformation pour les formateurs d’enseignants, les formateurs de formateurs, et les concepteurs de manuels, sur la comparaison linguistique et les
démarches de transfert ; - aider à renforcer de ce fait les capacités des enseignants du primaire bilingue dans les démarches pour traiter du français en s’appuyant sur la L1 ;
- offrir des exemples adaptables de supports d’activités de langage permettant ce travail bilingue sur les structures de la langue ;
- transmettre aux enseignants du primaire bilingue accompagnés par leurs encadreurs le goût de la réflexion sur leurs L1, en attendant que la formation initiale des maitres bilingues fasse toute la place souhaitable à cet aspect dans les programmes de formation.
© IFEF, 2024
Première parution en 2020 par le programme
Ecole et langues nationales (ELAN).
Rédaction par le programme ELAN et son groupe d’experts.
ISBN: 978-92-9028-785-8 (papier)
ISBN: 978-92-9028-786-5 (numérique)
Licence : CC BY-NC-SA 4.0

Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International
Cette publication peut être citée comme suit : « IFEF (2020). Guide des pratiques de transfert linguistique dans une approche bi-plurilingue. Dakar, Programme ELAN. »
- Année de publication : 2024
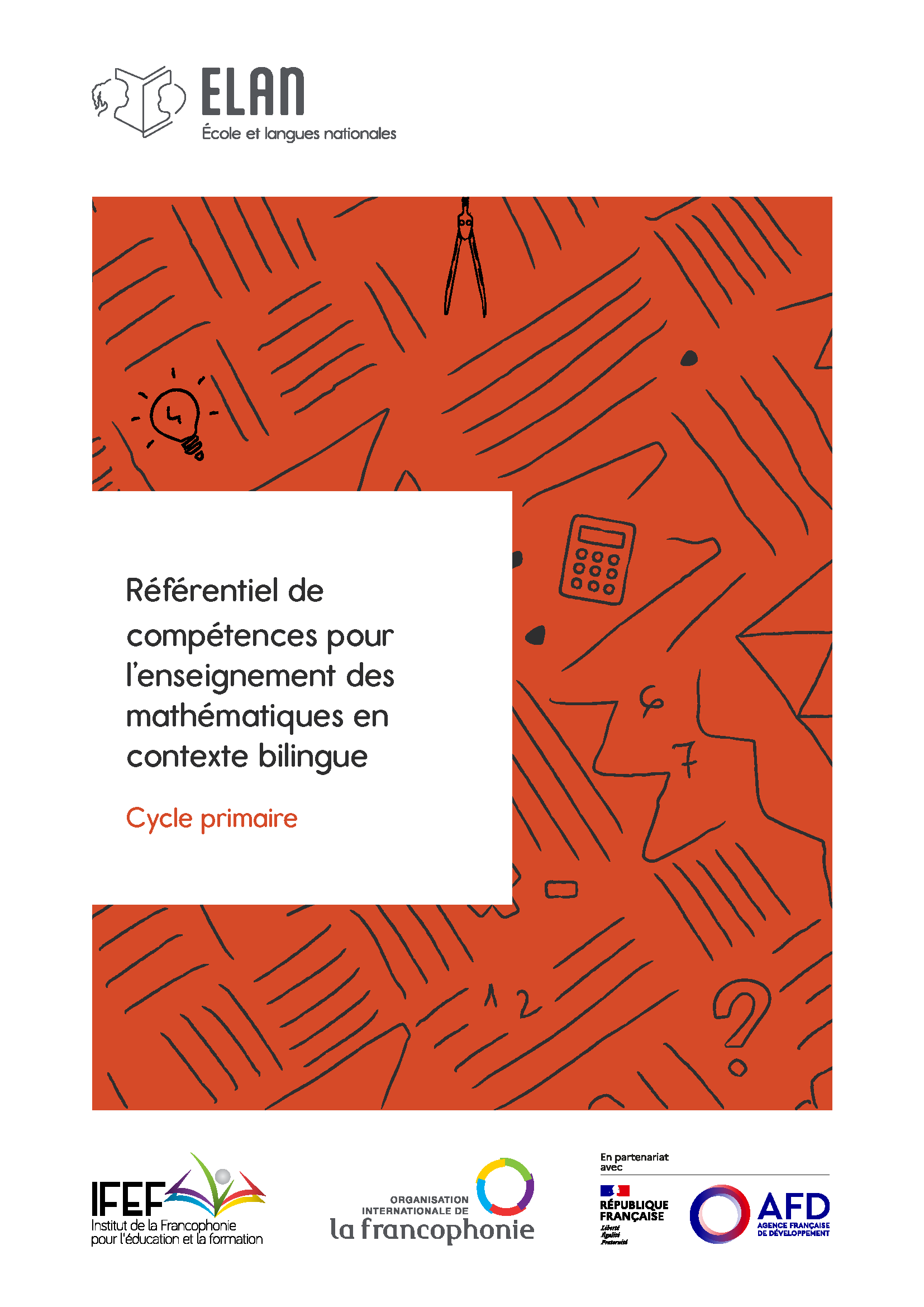
- Guide
Le présent référentiel constitue un outil de planification et d’évaluation pour le formateur ou la formatrice et l’enseignant ou l’enseignante en situation bi-plurilingue.
Description
Le présent référentiel de compétences des mathématiques constitue un outil d’orientation pour la mise en œuvre de l’enseignement des mathématiques en contexte bilingue. Il est organisé autour des sous-domaines/champs du domaine des mathématiques : activités de géométrie, activités numériques, arithmétique), activités de mesure et activités de résolution de problèmes.
© IFEF, 2024
Première parution en 2019 par le programme
Ecole et langues nationales (ELAN).
Auteurs :
- Mangary KA
- Kondo KABORE
- Amadou MAMOUDOU
SBN : 978-92-9028-787-2 (papier)
ISBN : 978-92-9028-788-9 (numérique)
Licence : CC BY-NC-SA 4.0

Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International
Cette publication peut être citée comme suit : « IFEF (2019). Référentiel de compétences pour l’enseignement des mathématiques en contexte bilingue. Dakar, Programme ELAN. »
- Année de publication : 2024

- Article
Résumé
Cet article propose des pistes de réflexion et d’analyse de l’impact de l’enseignement bilingue langues nationales/français au Burkina Faso et plus particulièrement du programme ELAN. Depuis l’adhésion du pays au programme en 2012, des progrès ont été réalisés, notamment avec l’adoption en 2024 d’une formule unique pour l’enseignement bilingue. Les résultats à l’examen du Certificat d’Études Primaires (CEP) montrent des performances prometteuses des élèves des écoles bilingues, avec un taux de réussite de 78 % en 2024. Ces résultats sont d’autant plus significatifs qu’ils sont obtenus en cinq ans de scolarité primaire au lieu de six pour les écoles classiques. L’approche ELAN est également appréciée pour sa méthode rapide d’enseignement de la lecture-écriture, favorisant de meilleurs résultats scolaires, y compris en langue française, tout en renforçant l’usage des langues nationales.
© IFEF, 2025
Ecole et langues nationales (ELAN)
Auteure : Marion Poutrel
Licence : CC BY-NC-SA 4.0

Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International
Cette publication peut être citée comme suit : « IFEF (2025). Zoom sur Burkina Faso – Enseignement bilingue : et si cinq années de primaire suffisaient ?. Dakar, IFEF. »
- Année de publication : 2025
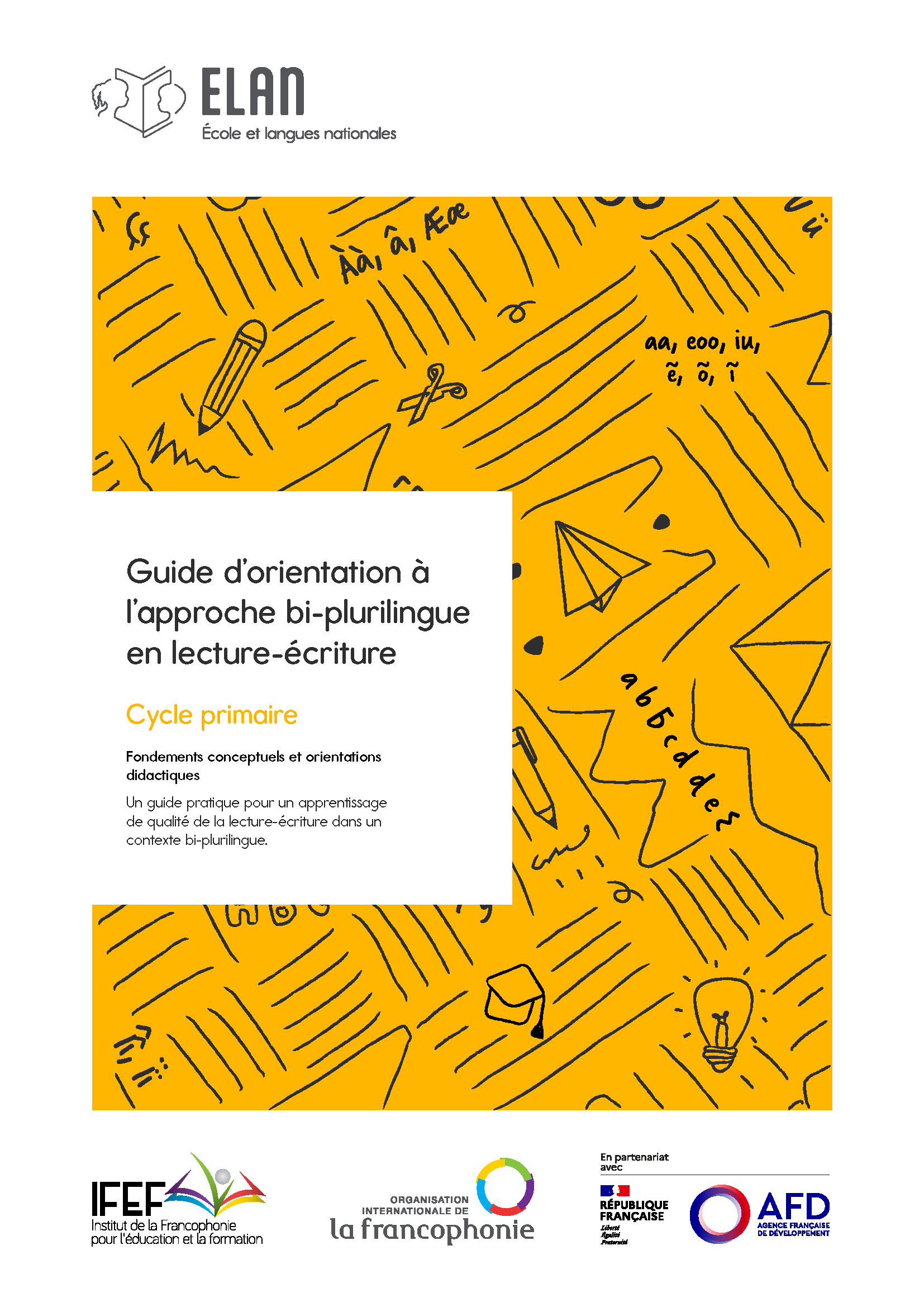
- Guide
Le présent guide constitue un outil de base visant à expliciter l’approche ELAN en lecture-écriture. Il fournit les éléments d’un cadre théorique et méthodologique ainsi que des orientations didactiques pratiques appropriées à des contextes bi-plurilingues.
Description
Il sert de document de travail pour toute la scolarité du primaire (ou des premiers cycles du fondamental). Les principes et les pratiques correspondantes, sur lesquels repose ce guide, font référence aux résultats des recherches actuelles, prennent en compte les évaluations de l’expérimentation de l’initiative ELAN dans sa première phase ainsi que la discussion de cette approche lors du séminaire « Lire et écrire en contexte plurilingue : améliorer les premiers apprentissages en Afrique, un défi pour la francophonie », séminaire qui s’est tenu à Dakar en 2016 sous l’égide du ministère français des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI), actuellement ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) , de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de l’Agence française de développement (AFD), du Centre international d’études pédagogiques (CIEP), actuellement France éducation international (FEI), et de l’Institut français (IF).
Le présent guide constitue une actualisation et une réécriture des deux guides élaborés en 2013 et 2014.
Ce guide, utilisé en lien avec le référentiel bilingue de compétences de l’élève pour la scolarité primaire, est destiné, selon les chapitres et les aspects traités, à trois publics concernés par l’Initiative ELAN :
- Les concepteurs d’outils didactiques (manuel scolaire, livret de l’élève) de chacun des 12 pays concernés par l’initiative ELAN. Ces outils doivent prendre appui sur les orientations développées en didactique du bi-plurilinguisme, être conformes à l’approche ELAN et adaptés au contexte linguistique (les langues utilisées) et aux spécif icités du système éducatif du pays.
- Les formateurs d’enseignants appelés à concevoir des modules de formation en lecture-écriture et de façon plus générale en didactique du bi-plurilinguisme, à les utiliser au cours de sessions nationales de formation et à les exploiter dans des activités d’accompagnement de proximité des enseignants.
- Les enseignants impliqués dans la mise en oeuvre de cette approche à travers des comportements pédagogiques plus actifs, au niveau de la préparation des leçons et dans les pratiques de classes propres à l’enseignement-apprentissage de la lecture-écriture d’une langue nationale (L1) et du français (L2), en tenant compte du programme off iciel et des spécif icités de l’enseignement bilingue dans son pays.
Les bénéficiaires de l’approche ELAN sont les élèves. Cette approche doit, d’une part, les rendre capables de communiquer oralement ainsi que de lire et écrire et, d’autre part, les motiver, en les mettant dans des situations où ils comprennent les enjeux (sociaux, scolaires et ludiques) d’un dialogue, tout comme ceux de la lecture et de l’écriture.
© IFEF, 2024
Première parution en 2013 par le programme
Ecole et langues nationales (ELAN).
Rédaction par le programme ELAN et son groupe d’experts.
ISBN: 978-92-9028-777-3 (papier)
ISBN: 978-92-9028-778-0 (numérique)
Licence : CC BY-NC-SA 4.0

Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International
Cette publication peut être citée comme suit : « IFEF (2013). Guide d’orientation à l’approche bi-plurilingue en lecture-écriture. Dakar, Programme ELAN. »
- Année de publication : 2024
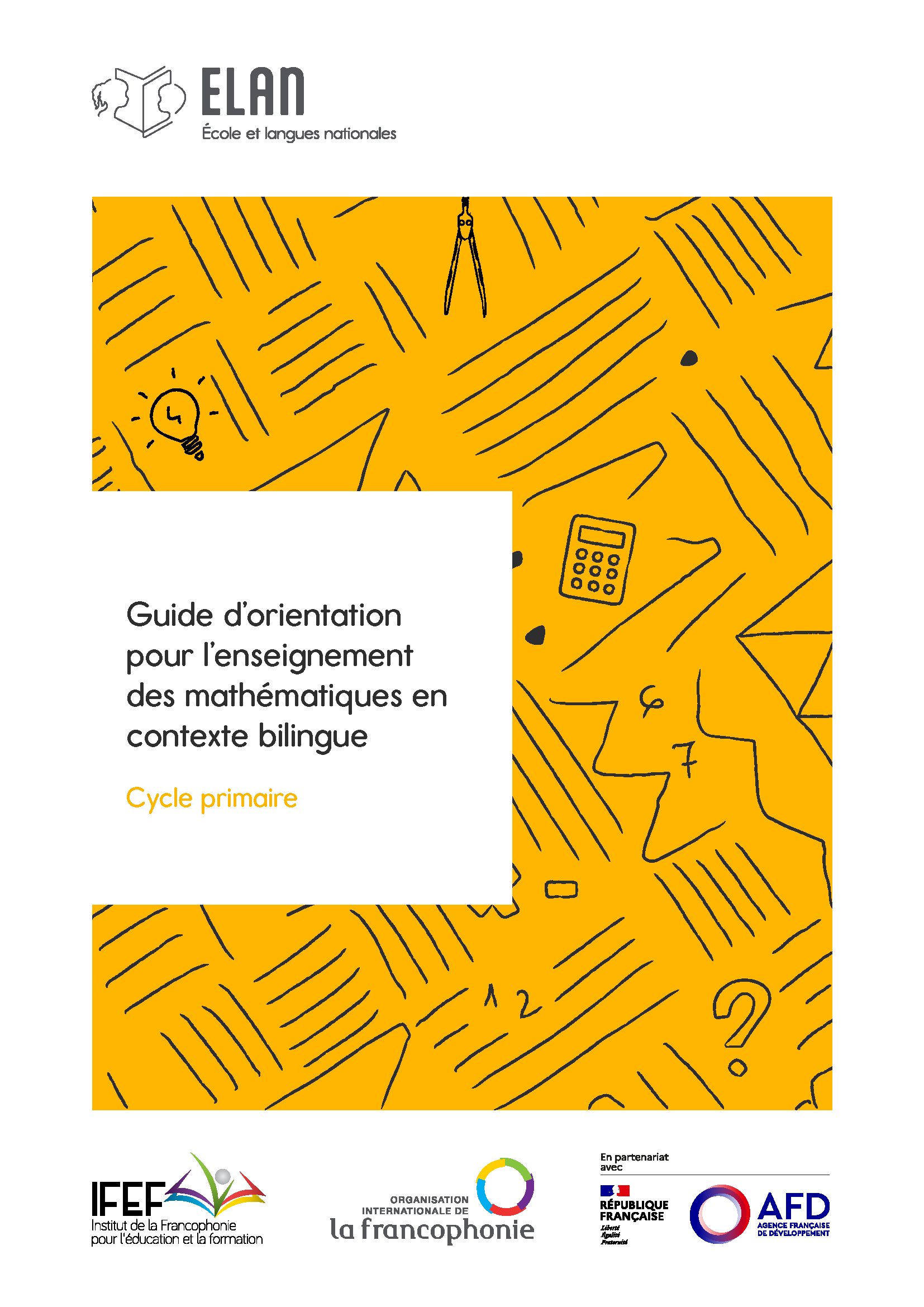
- Guide
Le présent guide constitue un cadre d’orientation de l’enseignement des mathématiques en contexte bi-plurilingue dans les pays partenaires de l’initiative ELAN.
Description
Compte tenu de la diversité des systèmes éducatifs concernés et des langues nationales, chacun des pays pourra développer, à partir de ce guide d’orientation générale, un cadre d’utilisation des langues nationales à l’école, des activités de formation des maîtres en mathématiques, ainsi que des outils pour la classe (guides pour le maître, manuels et cahiers d’activités pour l’élève) adaptés à ce cadre. Il concerne tous les niveaux du cycle primaire.
Le présent guide constitue une actualisation et une réécriture du guide élaboré en 2019.
Ce guide, utilisé en lien avec le référentiel bilingue de compétences de l’élève pour la scolarité primaire, est destiné, selon les chapitres et les aspects traités, à trois publics concernés par l’Initiative ELAN :
- Les concepteurs d’outils didactiques et pédagogiques (manuel scolaire, livret de l’élève) de chacun des 12 pays concernés par l’initiative ELAN. Ces outils doivent prendre appui sur les orientations développées en mathématiques, être conformes à l’approche ELAN et adaptés au contexte linguistique (les langues utilisées) et aux spécif icités du système éducatif du pays.
- Les formateurs d’enseignants appelés à concevoir des modules de formation en mathématiques, à les utiliser au cours de sessions nationales de formation et à les exploiter dans des activités d’accompagnement de proximité des enseignants.
- Les enseignants impliqués dans la mise en oeuvre de cette approche à travers des comportements pédagogiques plus actifs, au niveau de la préparation des leçons et dans les pratiques de classes propres à l’enseignement-apprentissage des mathématiques d’une langue nationale (L1) et du français (L2), en tenant compte du programme off iciel et des spécif icités de l’enseignement bilingue dans son pays.
Les bénéficiaires de l’approche ELAN sont les élèves. Cette approche doit, d’une part, les rendre capables de communiquer oralement ainsi que de lire, écrire et compter, d’autre part, les motiver, en les mettant dans des situations où ils comprennent les enjeux (sociaux, scolaires et ludiques) d’un dialogue, tout comme ceux de la lecture, de l’écriture et du calcul.
© IFEF, 2024
Première parution en 2019 par le programme
Ecole et langues nationales (ELAN).
Rédaction par :
Sophie Babault, université de Lille – UMR 8163 « Savoirs textes langage »
Denis Butlen, université de Cergy-Pontoise – Laboratoire de didactique André. Kalifa Traoré, École normale supérieure – université Norbert Zongo, Koudougou
Relecture par :
Mangary Ka, enseignant-chercheur, chef du département de mathématiques, Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation/UCAD, de Dakar, Sénégal.
Kondo Kabore, coordonnateur des programmes/formateur en didactique des mathématiques, Association de soutien aux initiatives de base (ASIBA), Burkina Faso.
Amadou Mamoudou, conseiller technique/inspecteur pédagogique mathématiques, ministère de l’Enseignement primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des langues nationales et de l’Éducation civique, Niger
SBN: 978-92-9028-779-7 (papier)
ISBN: 978-92-9028-780-3 (numérique)
Licence : CC BY-NC-SA 4.0

Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International
Cette publication peut être citée comme suit : «IFEF (2019). Guide d’orientation pour l’enseignement des mathématiques en contexte bilingue. Dakar, Programme ELAN. »
- Année de publication : 2024